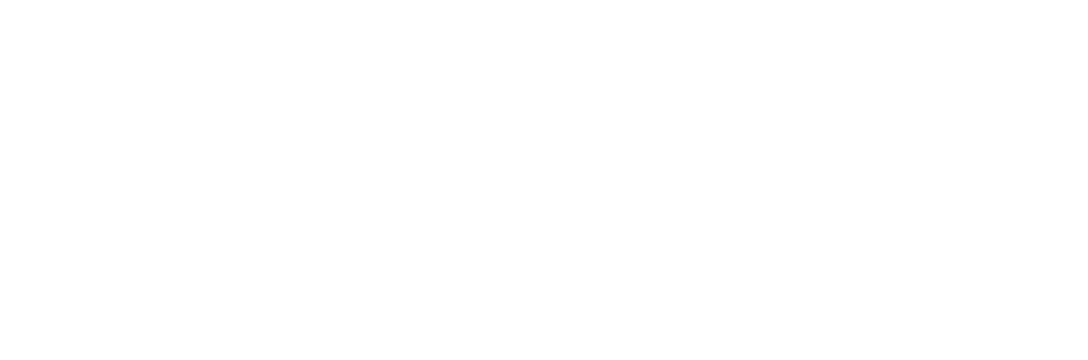Comment l’industrie de la pêche sénégalaise soutient les marchés mondiaux des produits de la mer
Avec ses 718 km de côtes atlantiques, le Sénégal s’impose comme un acteur clé de l’approvisionnement mondial en produits de la mer. Son secteur halieutique nourrit non seulement des millions de personnes localement, mais alimente aussi des marchés aussi divers que l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Asie.
3,2 % du PIB national proviennent directement de la pêche, générant 540 millions de dollars annuels lors des pics d’exportation. Le secteur emploie :
- 17 % de la population active (soit 600 000 emplois directs et indirects)
- 53 000 emplois directs dans la pêche artisanale et industrielle
- 10,2 % des exportations nationales, principalement vers l’UE et l’Asie
Tableau 1 : Répartition des emplois dans la filière (2025)
| Secteur | Emplois directs | Part des exportations |
| Pêche artisanale | 80 % | 60 % |
| Pêche industrielle | 15 % | 35 % |
| Aquaculture | 5 % | 5 % |
Innovation technologique : Le programme WISE (Wireless Solutions for Fisheries) a permis aux pêcheurs d’augmenter leurs revenus de 300 à 400 $ annuels grâce à des données météo et de marché en temps réel.
Produits phares à l’exportation
Le pays exporte annuellement 350 000 tonnes de produits halieutiques, dominés par :
- Thons certifiés MSC (première certification en Afrique de l’Ouest en 2024)
- Poulpes (20 % des exportations vers l’UE, prix moyen : 7,46 $/kg)
- Crevettes et langoustes royales (97 % vers la Chine, prix record à 19,75 $/kg)
Tableau 2 : Impact de la certification MSC sur les exportations (2024-2025)
| Indicateur | Avant certification | Après certification |
| Prix moyen du thon ($/kg) | 3,80 | 5,20 |
| Part de marché en UE | 18 % | 32,5 % |
| Emplois créés | 1 200 | 2 800 |
Défis et innovations durables
Face à la surpêche (baisse de 30 % des stocks depuis 2009), le Sénégal déploie des solutions innovantes :
- 8 aires marines protégées cogérées avec les pêcheurs locaux
- Quotas intelligents pour le poulpe (+20 % de biomasse en 3 ans)
- Drones de surveillance contre la pêche illégale (réduction de 40 % des activités IUU en 2024)
Crise des usines de farine de poisson : À Cayar, les communautés dénoncent la concurrence déloyale de 14 usines qui transforment 30 % des prises en farine animale, faisant grimper le prix de la sardinelle de 1 000 à 10 000 FCFA/kg depuis 2020.
Nouveaux marchés et tensions géopolitiques
L’UE en transition : L’accord de pêche avec l’UE (expiré en novembre 2024) est suspendu après un « carton jaune » pour pêche illégale. Le président Bassirou Diomaye Faye exige une révision complète des accords internationaux.
Émergence de l’Asie :
- La Chine importe 97 % des langoustes sénégalaises
- Le Vietnam investit 50 millions $ dans des unités de transformation locale
Tableau 3 : Comparaison des accords de pêche (2025)
| Partenaire | Tonnes autorisées | Redevances annuelles | Emplois locaux créés |
| UE | 14 000 | 8,7 millions € | 1 200 |
| Chine | 22 000 | 15 millions $ | 800 |
| Russie | 9 500 | 6,2 millions $ | 450 |
Aquaculture : le pari de demain
Le plan « Sénégal Émergent » vise à :
- Produire 68 000 tonnes/an d’ici 2032 (contre 1 600 tonnes en 2023)
- Créer 50 000 emplois via des fermes aquacoles high-tech
- Exporter 40 % de la production vers les marchés halal d’Afrique du Nord
Innovation clé :
- Écloseries publiques (capacité : 172 millions d’alevins/an)
- Aliments composés locaux à base de soja et de déchets de riz (coût réduit de 30 %)
Sécurité alimentaire : un équilibre fragile
Malgré des exportations record, la consommation locale de poisson a chuté de 29 à 16 kg/habitant/an entre 2009-2019. Les mesures d’urgence incluent :
- Interdiction d’exporter 6 espèces vulnérables (dont la sardinelle)
- Subventions de 10 milliards FCFA pour les mareyeurs locaux
- Réseaux de distribution communautaires (300 points de vente subventionnés)
Perspectives 2030 : entre ambitions et défis
Opportunités :
- +1,5 % de croissance annuelle prévue dans la production halieutique
- Marché africain en expansion (+58 % d’exportations depuis 2020)
- Nouveaux labels qualité (Bio, Fair Trade, MSC)
Risques majeurs :
- Conflits armés autour des zones de pêche (12 incidents mensuels en 2024)
- Érosion côtière (3 m/an à Saint-Louis)
- Dépendance aux capitaux étrangers (45 % des bateaux « sénégalais » sous pavillon fictif)
Avec 72 % des stocks exploités à leur maximum biologique, le Sénégal incarne à la fois les promesses et les dilemmes de l’économie bleue africaine. Sa capacité à concilier rentabilité économique, justice sociale et résilience écologique déterminera son rôle sur l’échiquier mondial des produits de la mer.