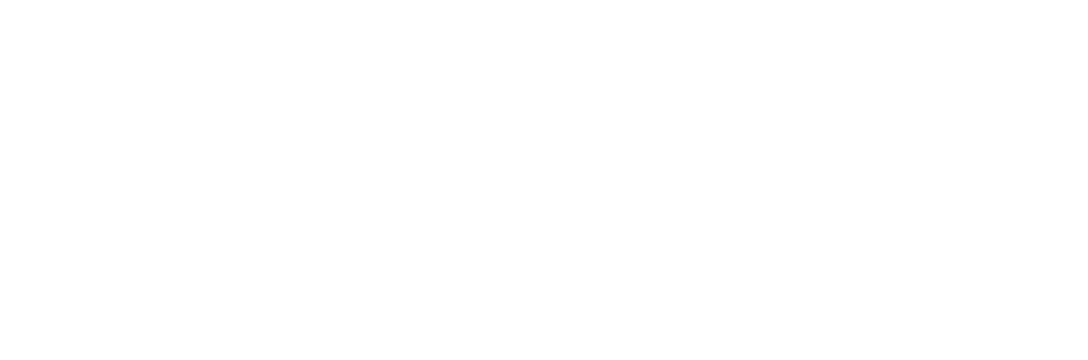Comment les satellites améliorent la surveillance du climat mondial
La surveillance du climat est un enjeu planétaire. Les satellites, véritables sentinelles de l’espace, ont révolutionné notre capacité à observer, analyser et anticiper les changements climatiques. Grâce à des technologies de pointe, ils fournissent des données précises et continues sur l’atmosphère, les océans, les terres émergées et les gaz à effet de serre. Cet article explore comment ces outils spatiaux transforment notre compréhension du climat et aident à orienter les politiques environnementales.
1. Des capteurs haute technologie pour une observation globale
Les satellites modernes embarquent des instruments de plus en plus sophistiqués, capables de mesurer une large gamme de paramètres climatiques essentiels avec une précision sans précédent. Parmi les technologies les plus avancées, on trouve :
- Sondeurs hyperspectraux : Ces instruments analysent la composition chimique de l’atmosphère en mesurant le rayonnement émis à différentes longueurs d’onde. Le sondeur IASI-NG (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer – New Generation), prévu pour 2025, offrira une précision 10 fois supérieure pour les profils de température et d’humidité atmosphérique.
- Lidars : Ces systèmes utilisent des impulsions laser pour cartographier les vents, les nuages et les aérosols. La mission Aeolus de l’ESA, lancée en 2018, a démontré l’efficacité de cette technologie pour améliorer les prévisions météorologiques.
- Altimètres radar : Ces instruments mesurent avec précision l’élévation du niveau des océans. La mission Sentinel-6 Michael Freilich, lancée en novembre 2020, peut mesurer les changements du niveau de la mer avec une précision millimétrique tous les 10 jours.
Tableau 1 : Comparaison des technologies satellitaires avancées (2025)
| Technologie | Paramètre mesuré | Exemple de mission | Précision |
| Sondeur infrarouge IASI-NG | CO₂, CH₄, N₂O | Metop-SG (EUMETSAT) | 10x supérieure à IASI |
| Lidar Aeolus | Profils de vent | Aeolus (ESA) | ±2 m/s jusqu’à 30 km d’altitude |
| Altimètre Sentinel-6 | Niveau des océans | Sentinel-6 (ESA/NASA) | ±1 mm tous les 10 jours |
L’avenir de l’observation satellitaire s’annonce prometteur, avec plus de 140 missions prévues d’ici 2040, embarquant plus de 400 instruments différents. Cette constellation croissante permettra une couverture mondiale et des relevés continus, indispensables pour détecter et analyser les tendances climatiques sur le long terme.
2. Cartographier les gaz à effet de serre avec une précision inégalée
Les satellites spécialisés dans la détection des gaz à effet de serre (GES) ont considérablement amélioré notre capacité à suivre et quantifier les émissions de CO₂ et de méthane (CH₄), responsables de 80 % du réchauffement climatique.
- Sentinel-5P (ESA) : Lancé en 2017, ce satellite peut identifier les fuites de méthane avec une résolution spatiale de 7 km². Il a permis de détecter des émissions importantes provenant de sites industriels et d’infrastructures gazières.
- OCO-2 (NASA) : Ce satellite cartographie le CO₂ à l’échelle urbaine, révélant l’impact des mégapoles sur les concentrations atmosphériques. Les données d’OCO-2 ont montré que les 20 plus grandes zones urbaines du monde sont responsables d’environ 20 % des émissions mondiales de CO₂ d’origine fossile.
- Merlin (CNES/DLR) : Prévu pour un lancement en 2027, ce satellite franco-allemand ciblera spécifiquement les sources de CH₄ avec une précision inédite, permettant de mieux comprendre le cycle du méthane et ses sources d’émission.
Tableau 2 : Émissions annuelles détectées par satellite (2024-2025)
| Gaz | Source majeure | Satellite utilisé | Quantité détectée (Mt/an) |
| CO₂ | Combustion fossile | OCO-2, Sentinel-5P | 36 200 ± 2 000 |
| CH₄ | Élevage, fuites de gazoducs | GHGSat, CarbonMapper | 570 ± 30 |
Ces données satellitaires alimentent l’inventaire mondial des GES prévu par l’Accord de Paris, offrant une transparence sans précédent sur les engagements climatiques des pays. En 2025, les nouvelles missions comme CarbonMapper et la constellation GHGSat permettront de détecter des fuites de méthane encore plus petites, jusqu’à 100 kg/h, contribuant à une réduction significative des émissions.
3. Des océans aux forêts : un rôle clé dans l’étude des écosystèmes
Les satellites jouent un rôle crucial dans la surveillance des indicateurs vitaux de la planète, offrant une perspective globale sur les changements des écosystèmes terrestres et marins.
- Élévation des océans : Les missions Jason et Sentinel-6 ont mesuré une hausse moyenne du niveau des mers de 3,3 mm/an entre 1993 et 2024. Le dernier rapport du GIEC, s’appuyant sur ces données, prévoit une augmentation de 28 à 55 cm d’ici 2100 dans le scénario le plus optimiste.
- Déforestation : Sentinel-2 peut détecter des perturbations forestières de seulement 0,5 hectare en Amazonie. Les données satellitaires montrent que la déforestation en Amazonie a augmenté de 22 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant son plus haut niveau depuis 15 ans.
- Glaces polaires : CryoSat-2 (ESA) suit la fonte des calottes glaciaires avec une précision de 1 cm. Les observations récentes révèlent que le Groenland et l’Antarctique perdent ensemble 418 milliards de tonnes de glace par an, contribuant significativement à l’élévation du niveau des mers.
Tableau 3 : Évolution des indicateurs environnementaux clés (2025)
| Indicateur | Valeur mesurée | Tendance |
| Élévation du niveau des mers | 3,3 mm/an | Accélération (+0,12 mm/an²) |
| Perte de forêt amazonienne | 10 100 km²/an | +22 % par rapport à 2023 |
| Perte de masse glaciaire | 418 Gt/an | Accélération (+26 Gt/an²) |
Ces séries de données remontant aux années 1990 permettent aux scientifiques d’isoler les causes naturelles des perturbations anthropiques, fournissant des preuves irréfutables du changement climatique en cours.
4. Renforcer la prévision météorologique et climatique
Les satellites géostationnaires comme GOES (NOAA) et Météosat (EUMETSAT) fournissent des images toutes les 15 minutes, permettant :
- D’anticiper les ouragans et canicules avec une précision accrue. En 2024, les prévisions de trajectoire des ouragans 5 jours à l’avance étaient aussi précises que les prévisions 3 jours à l’avance il y a dix ans.
- De surveiller les courants océaniques comme El Niño. Les satellites ont permis de prévoir l’événement El Niño de 2024-2025 six mois à l’avance, permettant une meilleure préparation.
- D’analyser la couverture nuageuse, cruciale pour le bilan radiatif terrestre. Les données satellitaires ont révélé une augmentation de 1 % de la couverture nuageuse globale depuis 1980, avec des impacts significatifs sur le climat.
Tableau 4 : Impact des satellites sur les prévisions (2025)
| Paramètre | Amélioration de la précision |
| Température atmosphérique | +45 % depuis 2000 (grâce à IASI-NG) |
| Prédiction des précipitations | +30 % (missions GPM et Metop-SG) |
| Prévision des trajectoires d’ouragans | +40 % à 5 jours d’échéance |
5. L’avenir : des satellites plus performants et des données ouvertes
D’ici 2030, plusieurs avancées majeures sont attendues :
- IASI-NG : Offrant une précision 10 fois supérieure pour les profils de température, ce sondeur révolutionnera notre compréhension de la chimie atmosphérique1.
- AOS (Aerosol and Cloud, Convection and Precipitation) : Un réseau international de satellites dédiés aux aérosols, nuages et précipitations, crucial pour comprendre les rétroactions climatiques.
- IA et Big Data : Le programme Copernicus de l’UE génère déjà 400 000 milliards de données par jour. L’utilisation de l’intelligence artificielle, comme sur le satellite Pelican-2 de Planet, permettra de traiter ces données en temps réel, offrant des insights immédiats sur l’évolution du climat.
- NISAR : Cette mission conjointe NASA-ISRO, prévue pour mars 2025, scannera presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours, fournissant des données sans précédent sur les écosystèmes, la cryosphère et la tectonique.
Conclusion
Les satellites sont devenus des outils indispensables dans la lutte contre le changement climatique. En combinant une couverture globale, une précision inégalée et une continuité des observations, ils offrent aux scientifiques et aux décideurs les données nécessaires pour comprendre et agir sur les changements environnementaux.
Le dernier rapport du GIEC s’appuie largement sur ces données satellitaires pour documenter l’accélération du changement climatique. Les observations montrent que les températures moyennes globales ont augmenté de 1,1°C depuis l’ère préindustrielle, avec 2024 enregistrée comme l’année la plus chaude jamais mesurée.
Alors que les missions futures promettent des avancées majeures dans notre capacité à surveiller et comprendre le système climatique, l’enjeu reste de maintenir un effort international coordonné. Cette collaboration est essentielle pour garantir une surveillance climatique fiable, transparente et capable de guider efficacement les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.