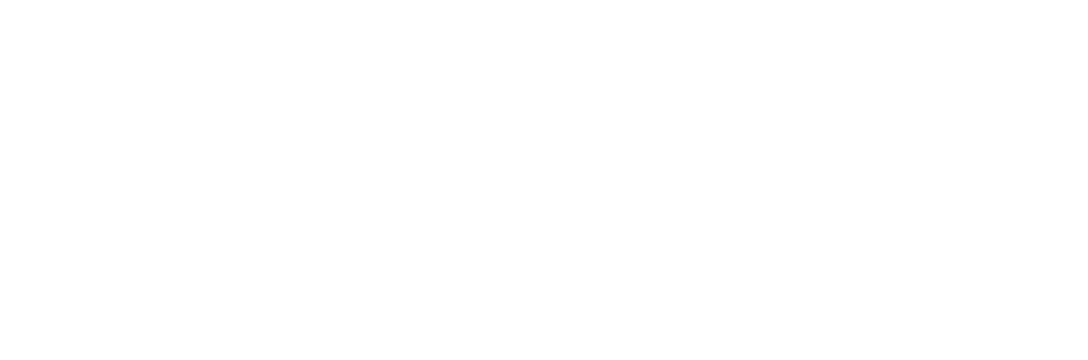6 lois sur les énergies renouvelables qui remodèlent les infrastructures françaises
La France s’est engagée dans une transformation profonde de ses infrastructures énergétiques pour répondre aux défis climatiques. Ces changements s’appuient sur un cadre législatif ambitieux, avec six lois majeures qui accélèrent le déploiement des énergies renouvelables. Cet article décrypte ces textes, leurs objectifs et leurs impacts concrets.
1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 : accélérer la production d’énergies renouvelables
Cette loi vise à rattraper le retard français en matière d’énergies vertes. Elle simplifie les procédures administratives et fixe des objectifs clairs :
- Multiplier par dix la production solaire d’ici 2050 (dépasser 100 GW).
- Déployer 40 GW d’éolien en mer et 40 GW d’éolien terrestre.
Mesures phares :
- Création de zones d’accélération pour les projets renouvelables, identifiées avec les communes.
- Simplification des délais d’autorisation (réduction de 50 % des délais d’instruction).
- Obligation d’installer des panneaux solaires sur les parkings de plus de 2 500 m².
Impact :
Cette loi structure la planification territoriale et mobilise le foncier artificialisé (friches, parkings) pour limiter l’artificialisation des sols.
2. Loi APER : adapter les infrastructures locales
La loi d’Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER) facilite le développement local des projets grâce à :
- Des démarches administratives simplifiées pour les porteurs de projets.
- Une meilleure intégration des citoyens et collectivités via le financement participatif.
Exemple concret :
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau (S3RENR) mutualisent les coûts d’infrastructures entre producteurs, évitant les surcoûts pour les premiers entrants.
3. Loi Énergie-Climat (2019) : vers la neutralité carbone
Adoptée en 2019, cette loi inscrit l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et prévoit :
- L’interdiction des chaudières au charbon dès 2022.
- L’obligation d’un audit énergétique pour les logements classés F ou G (« passoires thermiques »).
Résultats :
En 2023, les énergies renouvelables ont représenté 21,7 % de la consommation électrique française, contre 19,3 % en 2020.
4. Loi Climat et Résilience (2021) : verdir les bâtiments et les territoires
Ce texte renforce les obligations en matière de rénovation énergétique et de développement des EnR :
- Panneaux solaires obligatoires sur les nouveaux entrepôts et bâtiments commerciaux ≥ 1 000 m².
- Plan de rénovation de 600 000 logements/an d’ici 2030.
Chiffre clé :
7,5 millions de logements sont considérés comme des passoires thermiques en France.
5. Loi de Transition Énergétique (2015) : les bases d’un modèle durable
Cette loi pionnière a lancé la dynamique actuelle avec :
- L’objectif de 32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030.
- La généralisation des Diagnostics de Performance Énergétique (DPE).
Avancées majeures :
Elle a permis une augmentation de 70 % de la capacité solaire installée entre 2015 et 2023.
6. Loi portant sur l’évolution du réseau électrique (2024) : préparer l’avenir
Face à l’intermittence des EnR, cette loi modernise le réseau électrique pour :
- Intégrer 40 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.
- Déployer des smart grids et des solutions de stockage (batteries, hydrogène).
Défis :
Le réseau doit absorber une capacité supplémentaire de 60 GW d’ici 2040, nécessitant des investissements de 30 à 40 milliards d’euros.
Tableau comparatif des objectifs clés
| Loi | Objectif principal | Échéance |
| Loi 2023-175 | 100 GW de solaire, 80 GW d’éolien | 2050 |
| Loi Énergie-Climat | Neutralité carbone | 2050 |
| Loi Climat et Résilience | Rénover 100 % des passoires thermiques | 2030 |
| Loi Transition Énergétique | 32 % d’énergies renouvelables | 2030 |
Conclusion
Ces six lois transforment radicalement le paysage énergétique français. En combinant simplification administrative, incitations financières et innovations technologiques, elles posent les bases d’une infrastructure résiliente et décarbonée. Toutefois, leur succès dépendra de la coordination entre acteurs publics, privés et citoyens.